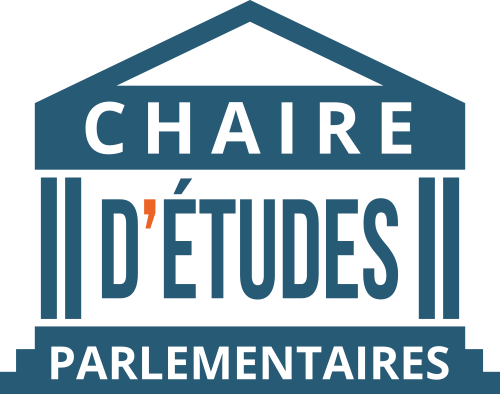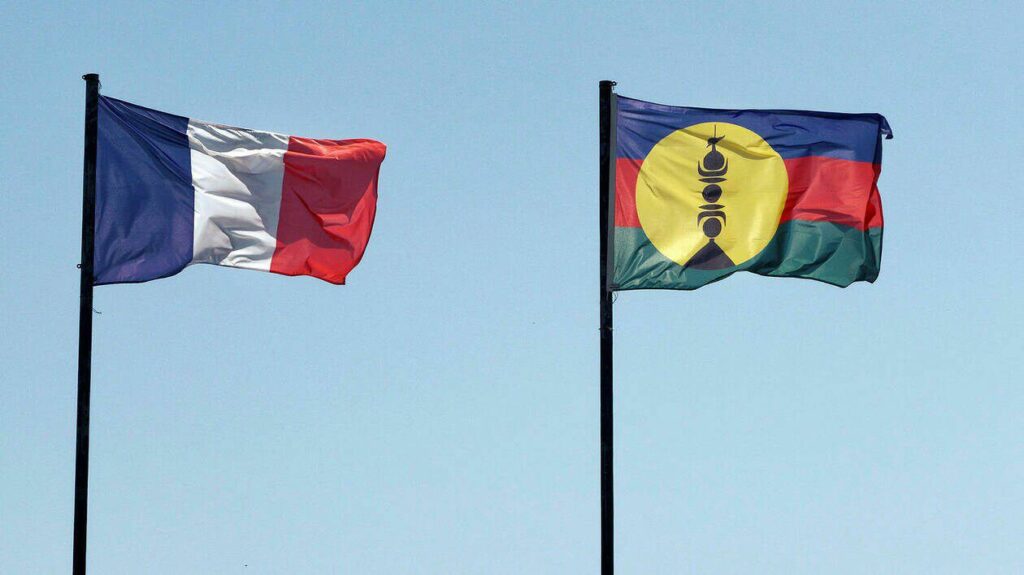Les deux Présidents des Assemblées, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, viennent de se rendre en Nouvelle-Calédonie pour tenter de renouer le dialogue. Quel rôle peuvent-ils jouer ?
L’avenir de la Nouvelle-Calédonie ne s’écrira pas avec la même méthode que celle imaginée par Michel Rocard. La signature des accords de Matignon-Oudinot en 1988 puis de l’Accord de Nouméa en 1998 ne peut plus servir de modèle. D’abord, parce que la conjoncture institutionnelle actuelle ne garantit plus la stabilité gouvernementale indispensable à l’engagement durable de l’État. Ensuite, car les émeutes insurrectionnelles de mai 2024 ont exacerbé les tensions entre les différentes communautés creusant une sourde méfiance entre les acteurs locaux. Enfin et surtout, en raison de l’urgence de la reconstruction de l’économie de l’archipel qui exige des décisions rapides. Dès lors, l’intérêt général impose que le Parlement occupe une place décisive, voire prépondérante.
Les deux assemblées partagent en effet avec le Président de la République, la véritable capacité d’action dont a besoin la Nouvelle-Calédonie pour sortir de l’ornière dans laquelle elle s’est enfoncée depuis la proclamation de l’état d’urgence le 16 mai dernier. Il est donc heureux que Yaël Braun Pivet et Gérard Larcher aient conjointement décidé de s’investir pour favoriser une reprise de l’indispensable dialogue politique. Dans l’archipel, le temps n’est pas un allié, il joue même « contre les intérêts de cette terre et de ses citoyens » pour reprendre les mots du président du Sénat. Or depuis des mois, le pouvoir exécutif est évanescent et son action illisible, ce qui est lourdement préjudiciable. L’immobilisme transforme les lignes politiques en fortifications, rendant le dialogue de plus en plus difficile. L’impasse politique se nourrit de cette radicalisation.
Quel est alors l’intérêt de la loi organique prorogeant le mandat des membres des assemblées de Province et du Congrès de Nouvelle-Calédonie qui vient d’être votée et validée par le Conseil constitutionnel ?
Ce texte était devenu indispensable. Les élections dans les trois provinces calédoniennes (Province Sud, Province Nord et Province des îles Loyautés) étaient initialement prévues, au plus tard le 12 mai 2024. Mais compte tenu du dépôt du projet de loi constitutionnelle sur ce qu’il est convenu d’appeler « le dégel du corps électoral » et de son adoption par le Sénat en janvier 2024 puis par l’Assemblée en mai dernier, le gouvernement avait proposé de reporter une première fois ces renouvellements au 15 décembre 2024. Il avait expliqué que ce délai pouvait permettre la conclusion d’un accord global relatif à l’avenir institutionnel de l’archipel entre les représentants indépendantistes, les représentants non-indépendantistes et l’État.
Sauf que l’histoire ne s’est pas écrite ainsi, bien au contraire. Le texte gouvernemental a été ressenti par le FLNKS comme une provocation et en réaction de violentes émeutes ont éclaté, donnant lieu à des pillages et à des attaques contre les forces de l’ordre. Treize personnes sont décédées, plus de 6 000 emplois ont été supprimés en raison des destructions des entreprises et de nombreuses infrastructures publiques et privées sont lourdement dégradées (écoles, routes, hôpitaux, etc.). Le coût économique de la crise était estimé à plus de deux milliards d’euros au début du mois de juillet 2024.
Comment concevoir dans de telles conditions que les Provinciales se déroulent tranquillement en décembre prochain ? La proposition de loi organique déposée par le groupe socialiste du Sénat dès le 16 octobre est apparue comme opportune au gouvernement Barnier qui l’a appuyée, permettant son adoption le 23 octobre puis le lendemain par l’Assemblée nationale. Elle a été promulguée le 16 novembre et prévoit, par dérogation au premier alinéa de l’article 187 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, que ces élections auront lieu au plus tard le 30 novembre 2025.
Mais si ce report est logique, il ne règle rien. D’abord, parce qu’en Calédonie comme en métropole, la perspective d’une élection prochaine entraine les forces politiques à durcir leurs positions pour espérer en tirer un profit électoral. Or cette rigidité contraste avec la réalité quotidienne des calédoniens caractérisée par une accélération de la précarité dont témoignent divers indicateurs (hausse des impayés de loyers, explosion des marchés de seconde main, accroissement des découverts bancaires, etc.). Les chefs d’entreprise ne sont pas moins critiques ne cessant d’alerter sur une économie en berne qui n’arrive pas à redémarrer.
Ensuite parce que, pour qu’un dialogue puisse reprendre, il faut des interlocuteurs solides et mandatés. Or la division ravage tous les camps. Deux partis fondateurs du FLNKS (le Parti de libération kanak [Palika] et l’Union progressiste en Mélanésie [UPM]) viennent de décider de s’en éloigner, estimant que les décisions du dernier congrès ne correspondent pas à leurs propres convictions. De même, les antipathies personnelles empêchent les loyalistes de se rassembler sur un projet partagé, les uns viennent de présenter leur projet de « fédération territoriale » et les autres défendent des « propositions de convergences entre Calédoniens pour un grand accord ». Ainsi, les forces politiques sont toujours plus polarisées mais encore bien plus morcelées. Quant à l’État, nul ne sait avec certitude qui pilote ce dossier en son sein.
Enfin parce que la date précise n’est pas arrêtée et ce n’est pas anodin. Si elle devait se situer au premier semestre, alors l’élection pourrait se tenir avec l’actuel corps électoral gelé ce qui ne serait pas nécessairement le cas si le choix se portait sur l’automne. Dès lors, il serait sans doute plus prudent de ne pas trop tarder à décider. De surcroît, un renouvellement au printemps permettrait le retour d’élus légitimes capables d’engager la réflexion de fond qu’appelle la Nouvelle Calédonie.
Si les freins sont nombreux, quels peuvent être a contrario les leviers utiles à la résolution des difficultés ?
A l’évidence, le déplacement des deux présidents a trouvé un écho dans le Congrès de Nouvelle Calédonie et notamment chez sa présidente Veylma Falaeo, issue de l’Éveil océanien, un petit parti charnière. Les différents présidents de groupe ont déjà montré qu’ils étaient capables de dépasser leurs querelles habituelles pour s’unir sur des initiatives précises. Ainsi en ce moment, et pour la seconde fois, une délégation du Congrès est à Paris pour promouvoir le « plan quinquennal de reconstruction » qui a été voté le 28 août à l’initiative de Calédonie ensemble.
Parallèlement, du 25 au 29 novembre, l’ancien directeur de cabinet de Gabriel Attal à Matignon, Emmanuel Moulin, sera à Nouméa pour « affiner le diagnostic » du gouvernement afin de créer la « délégation interministérielle placée auprès du Premier ministre et du ministre chargé des outre-mer » annoncée par le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale à l’Assemblée le 1er octobre. Il a déjà pris contact avec les forces économiques qui attendent beaucoup de lui car, pour le moment, l’aide de l’État s’est focalisée sur la destruction des entreprises brûlées, et non sur la reconstruction de l’économie et la survie des entreprises encore en activité. Pour les chefs d’entreprises, il faut plutôt porter l’attention sur ces dernières, car les autres sont sécurisées dans des processus d’assurances.
Comment enfin ne pas évoquer la précieuse malléabilité du droit ? Depuis trente-six ans, il s’est mis au diapason des faits par une lecture assurément constructive de ses ressources. « Je savoure à l’avance la perplexité des professeurs de droit public devant la nouveauté et l’étrangeté de l’objet constitutionnel que vous venez d’inventer… Le concept de droit évolutif en matière de souveraineté est radicalement nouveau », s’amusait par anticipation Michel Rocard au moment de la signature de l’Accord de Nouméa. Et de fait, pour chaque question, pour tous les sujets, la réponse élaborée fut empirique, à l’abri des grands schémas théoriques préétablis et des constructions idéologiques dominantes. En utilisant le droit dans les capacités d’action qu’il procure, les calédoniens ont ainsi démontré que les réponses relevaient essentiellement de la dynamique propre à la politique. Gageons qu’ils y parviendront encore !