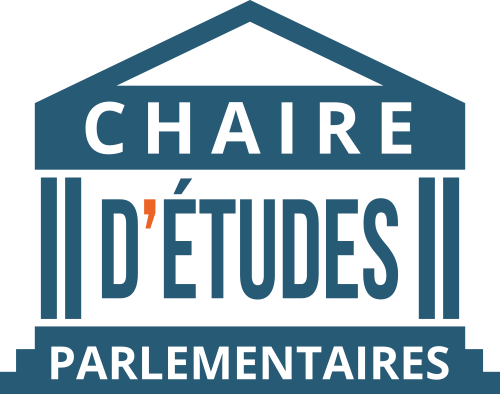Lors de son discours de politique générale, mardi 1er octobre, le Premier ministre a esquissé un changement de méthode. Michel Barnier s’engage à s’appuyer sur le travail parlementaire et revendique une « culture du compromis ». Il met en avant un « contrat de responsabilité » avec les collectivités locales et appelle à un « renouveau » du dialogue social.
- « Il y a un état d’esprit Barnier mais trop de flou pour parler d’une méthode », Olivier Rouquan, politologue
Avant même ce discours de politique générale, la composition du gouvernement Barnier manifestait la volonté de s’appuyer sur les différentes composantes de la vie politique. Plusieurs ministres viennent du Sénat qui est la chambre des territoires. Des portefeuilles comme ceux des collectivités locales, de la ruralité ou des transports sont confiés à des personnalités bien identifiées comme étant capables de nourrir le dialogue avec le terrain.
Durant son discours, Michel Barnier aura beaucoup employé ce mot de dialogue. Mais si cette rhétorique traduit un état d’esprit, manifeste une bonne volonté, il y a encore beaucoup trop de flou pour y voir une méthode. En ce qui concerne les rapports avec les collectivités locales, je n’ai rien entendu qui augure un changement de relations, dans un contexte marqué par de fortes tensions financières.
Avant son départ de Bercy, Bruno Le Maire avait critiqué l’endettement des collectivités qui ont pourtant une gestion globalement plutôt saine. Avec les débats budgétaires difficiles à venir, Michel Barnier aurait pu faire un geste envers les collectivités, par exemple envisager de leur redonner un peu d’autonomie fiscale comme elles le réclament.
Au lieu de cela, il recourt à la formule extrêmement vague de« contractualisation ». Cela évoque surtout la politique mise en place en 2017 par Emmanuel Macron avec les fameux « contrats de Cahors » qui conditionnaient les dotations de l’État aux collectivités à des efforts de maîtrise des dépenses. De même sur la décentralisation, il ne dit rien de précis. Son insistance sur la place des maires est un grand classique – surtout depuis le grand débat national qui suivit la crise des gilets jaunes – dont s’accommode très bien l’État jacobin. N’oublions pas que si le maire est un élu très apprécié des Français, il est aussi un représentant de l’État.
L’expérience et la culture politique de Michel Barnier plaident pour que le dialogue soit facilité, mais cela se traduit peu par des engagements concrets à l’intention des corps intermédiaires. Sur le social, il dit sa confiance aux partenaires sociaux pour négocier sur l’emploi des seniors et sur l’indemnisation du chômage. Mais étant donné la faiblesse du dialogue social depuis quelques années, on voit mal comment cela peut aboutir sans un accompagnement de l’État. On est encore loin de ce qui avait été tenté sous François Hollande avec les « Grenelle » ou les conférences sociales.
On peut voir un même flou sur la place des associations. Lors de la passation des pouvoirs à Matignon, il avait insisté sur l’importance du bénévolat en France. On pouvait s’attendre à ce que cela débouche sur des développements dans le discours de politique générale. Mais là aussi, en l’absence de traduction concrète, on reste sur sa faim.
- « Michel Barnier est contraint par la configuration politique » Jean-Philippe Derosier, Professeur de droit constitutionnel à l’université de Lille et auteur du blog constitutiondecodee.fr
Je n’ai pas vraiment relevé de rupture fondamentale sur la méthode dans la déclaration de politique générale de Michel Barnier. C’est un classique des prises de fonction d’un nouveau premier ministre de s’engager à l’« écoute », au « respect » et au « dialogue » entre le gouvernement et le Parlement. Même si ce message n’est souvent guère suivi d’effets dans la pratique.
Le chef du gouvernement peut bien dire qu’il demandera à ses ministres « de s’appuyer davantage sur le travail parlementaire ». En réalité, ce n’est pas un choix, c’est une volonté subie, parce que c’est la configuration politique qui l’oblige à davantage négocier avec le Parlement. Nous sommes en effet dans une situation particulière, inaugurée en 2022 avec une majorité relative à l’Assemblée nationale. Depuis la dissolution et les élections législatives anticipées, cette majorité est devenue extrêmement relative et volatile puisqu’elle est bâtie autour d’un socle de quatre groupes qui totalisent 212 députés sur 577, ce qui suppose par conséquent l’abstention d’un cinquième groupe, le Rassemblement national à l’extrême droite.
À gros traits, et hors examen budgétaire qui prend le pas sur tout le reste, l’ordre du jour est ainsi divisé : un quart pour le contrôle de l’action du gouvernement et l’évaluation des politiques publiques ; un quart fixé par les assemblées ; la moitié fixée par le gouvernement. Ce dernier peut juridiquement y inscrire les projets de loi qu’il veut, mais il doit bien entendu politiquement tenir compte de la configuration politique, au risque de s’exposer à des rejets à répétition.
Sur cette moitié, le gouvernement peut en outre parfaitement inscrire des propositions d’initiative parlementaire. C’est ce que Michel Barnier a sous-entendu en se déclarant « prêt à un partage de l’ordre du jour plus important entre le gouvernement et le Parlement ». Nous verrons vite s’il concrétise sa volonté affichée de rupture, ou s’il en reste à un fonctionnement classique.
Enfin, lorsque le premier ministre entend « faire de la culture du compromis un principe de gouvernement », il risque de se heurter à la culture politique du pays qui a inventé le clivage droite-gauche, sous la Révolution française. Autrement dit, ce n’est pas qu’une question de mode de scrutin.
Une mésaventure, que le président de la République pourrait raconter à son premier ministre lors de leurs tête-à-tête, illustre bien cette spécificité française. En 2015, lorsqu’il était ministre de l’économie dans un gouvernement de gauche, Emmanuel Macron avait consacré énormément de temps à l’Assemblée nationale à discuter avec tous. Finalement, chacun est retourné dans ses retranchements : une partie de la gauche – les « frondeurs » – a refusé de voter un texte qui incorporait trop de concessions à la droite, celle-ci refusant de voter un texte présenté par la gauche. La fameuse loi Macron a donc été adoptée par 49.3, ce qui n’était pas arrivé depuis dix ans.