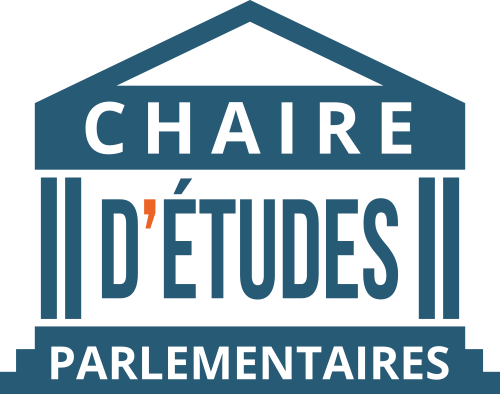Il s’agit sans doute de la seule procédure parlementaire à avoir servi de ressort dramatique à un long-métrage hollywoodien. Dans Monsieur Smith au Sénat (Mr. Smith Goes to Washington), l’un des classiques de Frank Capra, le personnage principal, incarné par James Stewart, utilise la technique de la flibuste pour bloquer à lui seul l’adoption d’un projet de loi conçu par des sénateurs corrompus. En effet, au Sénat américain, chaque parlementaire dispose d’un droit quasi absolu à la parole. De ce principe provient l’arme dont dispose une minorité, même très réduite, pour paralyser l’action de la majorité : la flibuste, ou filibuster. Quelques sénateurs bien organisés peuvent « causer jusqu’à la mort » (talk to death) d’une proposition, car il sera très difficile de leur retirer la parole.
Exemple marquant d’obstruction collective, la flibuste contre la loi sur les droits civiques dura du 30 mars au 10 juin 1964, date à laquelle la clôture du débat fut votée par 71 voix contre 29. Quant au plus long discours individuel, on le doit désormais au sénateur démocrate du New Jersey Cory Booker. Les 31 mars et 1er avril 2025, il conserva la parole durant 25 heures et 5 minutes afin de protester contre les mesures prises depuis le début de la seconde présidence Trump. Il faisait ainsi finalement tomber le vieux record du sénateur démocrate Strom Thurmond. En 1957, à l’occasion d’un effort épique contre la première loi sur les droits civiques, il avait monopolisé la parole durant 24 heures et 18 minutes en lisant d’une couverture à l’autre l’annuaire téléphonique.
Cela étant, le discours de Cory Booker n’était pas à proprement parler une obstruction puisque le vote était déjà terminé : le sénateur a donc seulement « piraté » le fonctionnement normal du Sénat, sans bloquer l’adoption d’un texte ou la confirmation d’une nomination. « Je me lève avec l’intention de perturber le déroulement normal des travaux du Sénat aussi longtemps que je le pourrai physiquement » (1) avait-il d’ailleurs annoncé après avoir obtenu la parole.
De tels marathons oratoires à la James Stewart sont révélateurs du caractère profondément individualiste et contre-majoritaire du Sénat. La plus puissante assemblée du monde n’a jamais pris le chemin du parlementarisme et s’attache à conserver les particularismes qui la distinguent de toutes les autres.
Fondement procédural du filibuster : le droit illimité au débat
Au Sénat, les débats sont encadrés beaucoup plus lâchement qu’à la Chambre des représentants. Ils sont principalement régis par les dispositions de la règle XIX 1 (a) du règlement intérieur du Sénat :
« Lorsqu’un sénateur désire prendre la parole, il doit se lever et s’adresser au président de séance. Il ne peut intervenir qu’après avoir obtenu la parole, que le président de séance accorde d’abord au sénateur qui s’est adressé à lui en premier. Aucun sénateur ne peut interrompre un autre sénateur dans un débat sans son consentement ; pour obtenir ce consentement, il doit d’abord s’adresser au président de séance. De plus, aucun sénateur ne peut intervenir plus de deux fois sur une même question en débat au cours d’une même journée législative sans l’autorisation du Sénat, laquelle est accordée sans débat ».
Le contenu de cette règle est finalement tout aussi important que ses lacunes. En effet, c’est la combinaison de deux éléments qui rend possible la flibuste : l’obligation pour le président de séance d’accorder la parole à tout sénateur la réclamant et surtout l’absence de disposition limitant la durée des interventions orales. Quelques sénateurs peuvent donc tirer profit de la règle XIX en prenant successivement la parole de manière continue, et ce jusqu’à épuisement physique, afin de ralentir, voire de bloquer totalement, le processus parlementaire.
Une telle manœuvre sera très difficile à surmonter car la clôture du débat, prévue par la règle XXII, ne pourra être invoquée que si au moins les trois cinquièmes de l’ensemble des sénateurs en exercice votent en sa faveur, soit 60 sénateurs s’il n’y a pas plus d’un siège vacant. La véritable majorité du Sénat réside donc dans le « chiffre magique » de 60 sénateurs rendu nécessaire pour surmonter une obstruction, et non dans celui de 51, qui constitue pourtant la majorité absolue.
Conduite du Filibuster
Simple mais physiquement éprouvant ! Un sénateur demande la parole puis, une fois obtenue, la conserve aussi longtemps que possible. Lorsqu’il a terminé, un autre lui succède immédiatement. Le débat peut continuer par ce moyen jusqu’à ce que tous les sénateurs participant au filibuster aient épuisé leurs deux interventions sur la question (two-speech rule). Il est ensuite encore possible de proposer un amendement ou une quelconque motion pour créer une nouvelle question sujette à débat, offrant ainsi aux sénateurs le droit à deux nouvelles interventions. À l’arrivée, bien que l’ambition affichée du filibuster soit de convaincre, ce qui importe le plus pour le mener à bien n’est pas qui parle, mais bien qu’à tout moment, quelqu’un parle, peu importe la position défendue, faisant ainsi gagner du temps aux adversaires de la mesure par la poursuite du débat.
Il n’y a aucune obligation à ce que les interventions des sénateurs portent sur la question débattue, à une exception près. Les dispositions de la règle XIX 1 (b) exigent que les interventions aient un rapport avec la question débattue durant les trois premières heures de la session quotidienne – sachant que le « jour » en question est une journée législative qui peut s’étendre sur plusieurs jours calendaires. Avant l’adoption de cette règle en 1964, il était possible pour un sénateur de parler d’absolument n’importe quoi à tout moment des débats.
Le sénateur qui a la parole doit se tenir debout (2) et parler de manière plus ou moins continue. Il ne peut céder provisoirement la parole à l’un de ses collègues sans y renoncer, sauf si celui-ci désire lui poser une question (3). Cette tactique permet à un sénateur de soulager quelque temps la voix d’un de ses collègues engagé dans une flibuste. Ce dernier doit cependant rester debout tandis que la question lui est posée. Elle permet surtout de gagner du temps en posant de longues questions suivies de courtes réponses, plutôt que de s’engager dans une série d’interminables discours sans interruption.
Perspectives
La pratique du filibuster s’était progressivement raréfiée au cours du XXe siècle, mais connaît une forte recrudescence depuis les années 1990 à la faveur d’une rebipolarisation de la vie politique américaine, démocrates comme républicains pratiquant l’obstruction systématique lorsqu’ils se trouvent dans la minorité. En 2013 puis 2017, les règles du Sénat furent modifiées pour limiter les effets du filibuster en matière de nominations – notamment à la Cour suprême – sans pour autant que sa suppression totale soit pour le moment à l’ordre du jour (4).
Souvent considéré comme « l’âme du Sénat » (5), le filibuster constitue une caractéristique intrinsèque d’un système politique américain qui reste par nature foncièrement contre-majoritaire dans son fonctionnement, car respectueux des droits des États et de la minorité. Nul doute que la disparition de ce qui n’apparaît souvent en France que comme une simple curiosité procédurale engendrerait un bouleversement des équilibres politiques et constitutionnels outre-Atlantique.
(1) Congressional Record, 31 mars 2025, p. S1932.
(2) Riddick’s Senate Procedure: Precedents and practices, 1992, p. 755.
(3) Ibid., p. 778.
(4) A. Braun, « “Option nucléaire” et nouvelle limitation du filibustering au Sénat des États-Unis », Civitas Europa, 2017, n° 39, pp. 237-241.
(5) R. A. Arenberg, R. B. Dove, Defending the Filibuster: The Soul of the Senate, Indiana University Press, 2012.