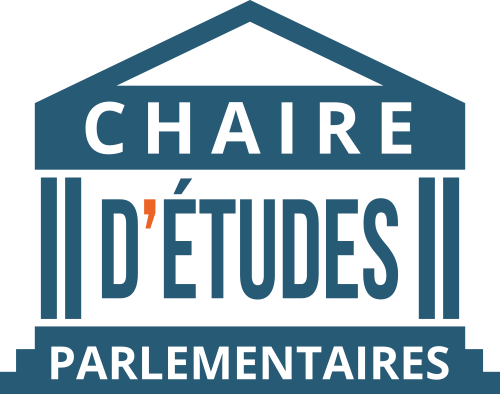Après avoir tiré le bilan de la crise sanitaire, de la décentralisation puis celui de l’action publique face au changement climatique (1), la Cour des comptes a axé son rapport public annuel 2025 sur les politiques publiques en faveur des jeunes.
Fruit de la contribution de 6 chambres de la Cour, de 17 chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC), de 5 formations inter-juridictions et de 55 rapporteurs, le rapport, fort de 616 pages, comporte quatre parties. Une première partie est dédiée à l’accès des jeunes à l’éducation et à la formation. Une deuxième aborde l’aide à l’entrée dans la vie active et autonome. Une troisième partie est consacrée aux politiques de prévention à destination de la jeunesse. Enfin, la quatrième partie traite de l’apprentissage à la citoyenneté et à la vie dans la cité.
Le rapport, qui formule 52 recommandations, alerte le Parlement sur l’insuffisance de sa politique publique en faveur des jeunes (I). Il révèle aussi à notre sens, une fois de plus, les difficultés à mettre en place l’évaluation des politiques publiques (II).
I. Une politique publique sectorielle insuffisamment prise en compte par le Parlement
Le rapport ne remet pas en cause l’utilité ou l’opportunité des politiques publiques à destination des jeunes. Les choses sont clairement affirmées : « Les politiques publiques en leur faveur ne sont pas seulement une réponse à des besoins immédiats : en accompagnant cette période charnière, elles permettent à chaque jeune de réaliser son potentiel tout en renforçant la cohésion sociale et le progrès collectif » (p.14 vol.1).
Pour autant, la Cour déplore la faible implication des pouvoirs publics dans la définition comme la mise en œuvre de plusieurs politiques publiques en faveur des jeunes. Tel est le cas de la politique de lutte contre l’échec à l’université, qui reste « sans effet durable à ce jour » (p.19 vol.1), ou celle de l’accès au logement pour laquelle la Cour relève qu’elle « n’est pas pensée comme un tout cohérent, quand bien même n’a-t-elle pas vocation à être homogène » (p.25 vol.1).
Par ailleurs, alors que l’Assemblée nationale examine en séance publique la proposition de loi adoptée visant à sortir la France du piège du narcotrafic et de loi organique fixant le statut du procureur de la République national anti-criminalité organisée, le rapport questionne le dispositif juridique de lutte contre le trafic de drogue applicable aux jeunes. Rappelant alors que « la France est l’un des pays d’Europe les plus concernés par la consommation de drogues et d’alcool des jeunes » (p.31 vol.1), le Cour souligne que « des mesures fortes de prévention doivent être proposées sans tarder pour limiter les effets souvent irréversibles de la consommation de drogues illicites et d’alcool » (p.32 vol.1).
Dans la même veine, la Cour revient sur le régime de protection accordée aux jeunes majeurs sortant de l’aide sociale à l’enfance, laquelle s’est élargie durant les dernières décennies, en particulier sous l’effet de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a rendu obligatoire la prise en charge jusqu’à leurs 21 ans de ceux qui sont sans ressources ou soutien familial suffisants ; loi qui n’est pas traduite par une hausse notable et uniforme de la proportion de jeunes majeurs pris en charge (p.27 vol.1).
Enfin, la place des jeunes dans la vie publique est aussi pointée par la Cour des comptes qui relève qu’ «à l’Assemblée nationale, 21 élus ont moins de 30 ans (pour 27 élus de plus de 70 ans) et deux au Sénat. Les données sur les scrutins locaux montrent que les moins de 40 ans, soit un tiers des électeurs, constituent 13 % des élus. Les jeunes sont nombreux à participer à la vie citoyenne sous des formes non institutionnalisées, en France comme ailleurs, passant notamment par les technologies numériques, qu’ils maîtrisent mieux que leurs aînés » (p.63 vol.1). En outre, s’agissant de la Journée Défense et Citoyenneté, communément appelée “JDC”, la Cour rappelle que si la loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national « a suspendu la conscription tout en prévoyant qu’elle puisse être rétablie par le Parlement en cas de nécessité » (p.133 vol. 2), elle considère que le dispositif est « à bout de souffle » (p.134 vol.2), « ses finalités doivent donc être actualisées et redéfinies en adéquation avec l’évolution du contexte » (p.134 vol. 2).
Tous ces exemples montrent combien le Parlement joue un rôle imparfait dans cette politique publique sectorielle. Plus largement, à notre sens, ce rapport fait état de l’insuffisance de l’évaluation de cette politique publique.
II. Une politique publique sectorielle, reflet des insuffisances de l’évaluation des politiques publiques
Le rapport de la Cour des comptes miroite frontalement avec les dispositions de l’article 24 de la Constitution qui, en son premier alinéa, dispose que « le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques ».
En pointant des difficultés de procéder à une évaluation de la politique publique en faveur des jeunes, notamment celle d’estimer la part spécifique « des différentes politiques publiques en faveur des jeunes dans les dispositifs de droit commun » (p.14 vol.1), on comprend du rapport combien le Parlement adopte des dispositifs juridiques et financiers sans concevoir ou pratiquer une méthode d’évaluation.
La Cour regrette également que l’évaluation soit sous mobilisée par une kyrielle de pouvoirs publics. Par exemple, « malgré des moyens publics estimés à au moins 2 milliards d’euros par an, l’efficacité de la politique pénale à destination des jeunes de 15 à 25 ans est incertaine (…). Les outils d’évaluation dont dispose l’État pour comprendre ce phénomène et adapter les outils de sa politique sont trop faibles » (p.37-38 vol.1). Dans le domaine de l’enseignement supérieur, comment ne pas mentionner le fait que « le pilotage de la politique de prévention de l’échec des étudiants inscrits en licence se heurte (…) à un manque d’évaluation, résultant d’un défaut de procédures et d’outils harmonisés, définis au niveau central » (p.182 vol.1).
Dans une telle configuration, on comprend aisément pourquoi la Cour préconise la mise en place d’outils de suivi et d’évaluation communs aux politiques en faveur des jeunes, en particulier « un plan stratégique (…) avec des outils communs de suivi et d’évaluation visant à disposer de données quantitatives et qualitatives probantes » (p.43 vol. 1).
On le voit, ce rapport constitue une énième illustration des réticences, qui brouillent la revalorisation des pouvoirs d’évaluation que détient désormais le Parlement. Si les pouvoirs du Parlement sont de plus en plus consistants d’un point de vue juridique, ils souffrent encore de nombreuses restrictions qui font douter de leur réalité et de leur effectivité (2). Ce rapport rappelle combien il est nécessaire sinon urgent, compte tenu de la forte dégradation de la soutenabilité des finances publiques et des profondes tensions qui traversent le système institutionnel français, de clarifier la place que le Parlement doit jouer dans l’évaluation budgétaire qui, de par le texte de la Constitution de 1958, se nourrit de l’expertise produite par la Cour des comptes dans le cadre de sa mission d’assistance. La révision constitutionnelle de 2008 a bouleversé la nature des débats se tenant au Parlement. En plaçant l’évaluation au cœur des relations entre le Parlement et la Cour des comptes, le pouvoir constituant a placé l’évaluation des politiques publiques entre les mains du Parlement ; ce dans quoi il doit encore s’investir.
Au-delà de la question de la fragilité de la politique publique en faveur des jeunes, qui en soi est un motif d’inquiétude, on peut voir à travers ce rapport (dont on peut parier qu’il partira vite aux oubliettes, à l’image des précédents), un signal d’alarme pour le Parlement qui doit revêtir les habits du pilote de l’évaluation des politiques publiques, en particulier de l’évaluation budgétaire, que lui a confectionné le pouvoir constituant en 2008.
(1) Baudu, A., Bin, F., Gaullier-Camus, F., Gourbier, L., Houser, M., Potteau, A. et Terrasse, Y. (2024) . Repères sur la gestion et les finances publiques, Mars 2024. Gestion & Finances Publiques, N° 3(3), 77-99.
(2) Moysan, E., Les pouvoirs budgétaires du Parlement à l’épreuve de la pratique de l’évaluation, Mare & Martin, 2023, p.59.